
| Bienvenue au Mont Saint Michel |
| Sur la baie du Mont-Saint-Michel |
| Le site touristique le plus fréquenté de Normandie |
| Site du patrimoine mondial. UNESCO |
| Toponymie |

| Les Gaulois |
| Romains |
| Le début de l'ère chrétienne |
| L'apparition de l'archange Michel |
| L'abbaye bénédictine |
| L'abandon |
| La Renaissance après la Révolution |

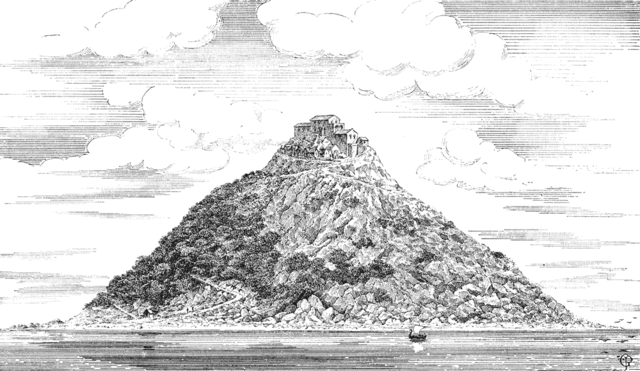
| La forêt de Scissy et l'invasion de la mer |
| L'ancien barrage d'accès |
| Le risque de dissimulation |
| Le projet de restauration de 2005 |
| Le pont-passerelle |
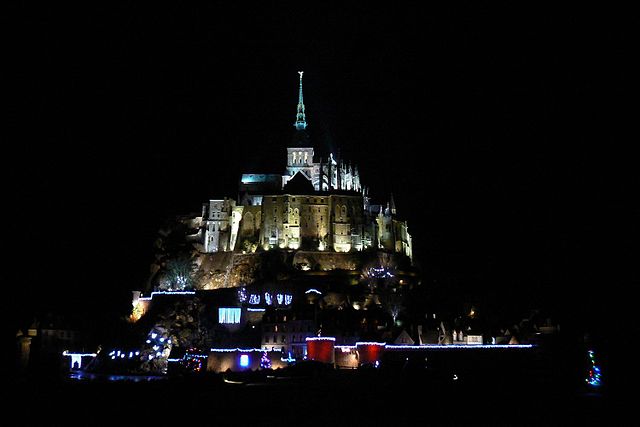
| L'entrée de la Citadelle |
| La Cour de l'Avancée |
| La Cour |
| La porte du Lion |
| La porte du roi |
| La maison du roi |
| La Grand'Rue |
| Le Chemin des Bastions |
| Les tours |
| La Cour de la Barbacane |
| Vers l'entrée de l'Abbaye |
| Renouveau religieux et développement touristique |
| Pèlerinages et tourisme religieux |
| Le développement du tourisme |
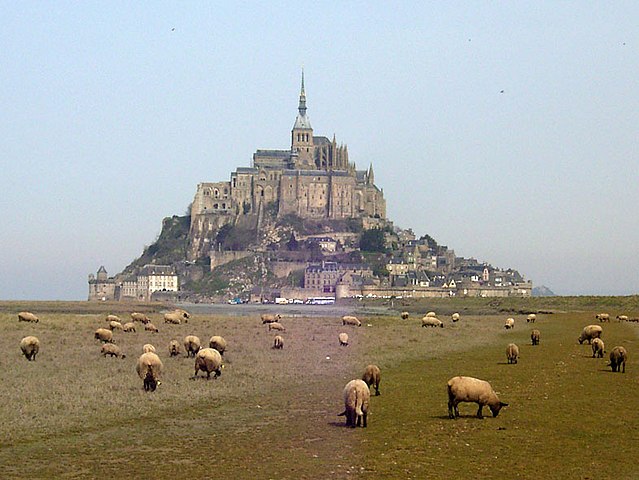
.jpg)
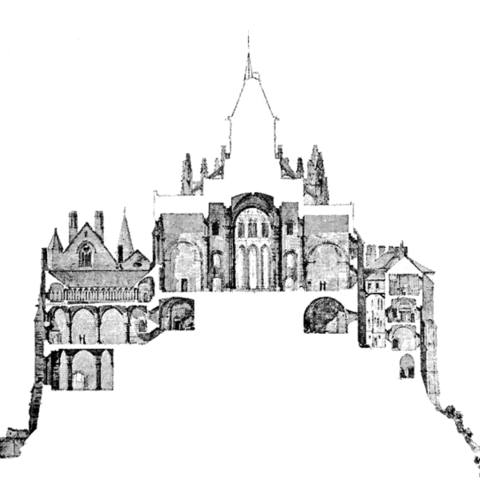

| Collégiale Saint-Michel aux IXe et Xe siècles |
| Les raids vikings |
| Fondation de l'abbaye bénédictine (965 ou 966) |
| Le Duc Ricardo |
| L'arrivée des Bénédictins |
| Les matériaux de construction |
| La conquête normande |
| Un centre de traduction au XIIe siècle |
| 13ème siècle |
| Le massacre de Guy de Thouars |
| La reconstitution de Philippe Auguste |
| Guerre de Cent Ans |
| 1356-1386 |
| 1417-1421 |
| 1423-1425 |
| La bataille du 16 juin 1425 |
| 1424-1425 |
| Le siège de 30 ans |
| La transformation en prison |
| La Bastille des Mers |
| La prison après la Révolution française |
| La fermeture de la prison en 1863 |
| L'église abbatiale |
| La nouvelle église abbatiale |
| Les reconstructions ultérieures |
| La nef |
| Le chœur gothique |
| Les cloches |
| Les Chapelles Souterraines : La Crypte des Gros-Piliers |
| Soubassements du transept : La Chapelle Saint Martin |
| Soubassements du transept : La Chapelle des Trente Bougies |
| Bâtiment de Roger II, au nord de la nef |
| La Sala dell'Aquilone (salle du cerf-volant) |
| Marche des moines |
| Dortoir |
| Bâtiments de Robert de Torigni |
| La Merveille et les Bâtiments Monastiques |
| La Merveille : partie Est |
| La Merveille : partie est, l'Oratoire |
| La Merveille : partie orientale, La Chambre d'Hôtes, (1215-1217) |
| La Merveille : Le Réfectoire (1217-1220). Le plus beau mur du monde |
| La Merveille : partie Est, la Chaire du Réfectoire |
| La Merveille : partie ouest |
| La Merveille : partie ouest, la Cave |
| La Merveille : partie ouest, Scriptorium ou Salle des Chevaliers (1220-1225) |
| La Merveille : partie ouest, Cloître (1225-1228) |
| La Merveille : partie ouest, Cuisines et Réfectoire |
| La Merveille : La troisième partie jamais construite |
| Belle Chaise et bâtiments au sud-est |







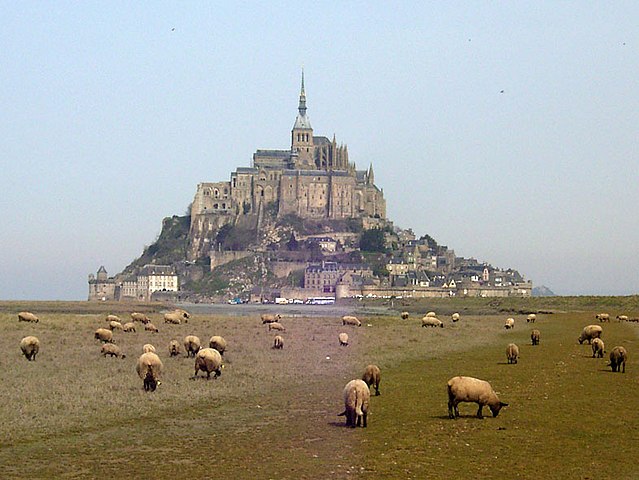
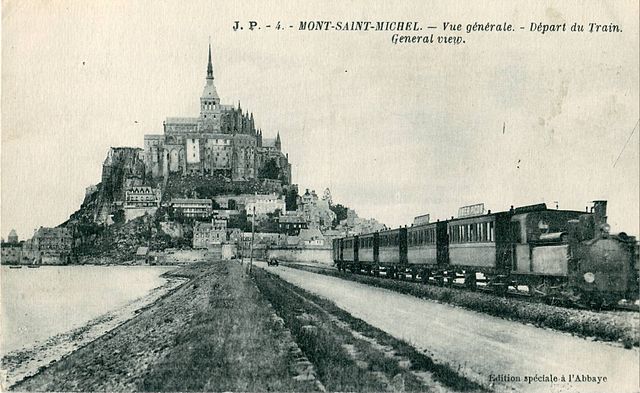


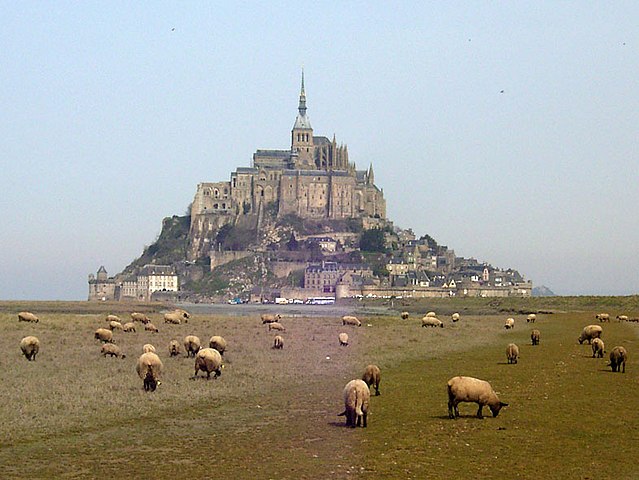
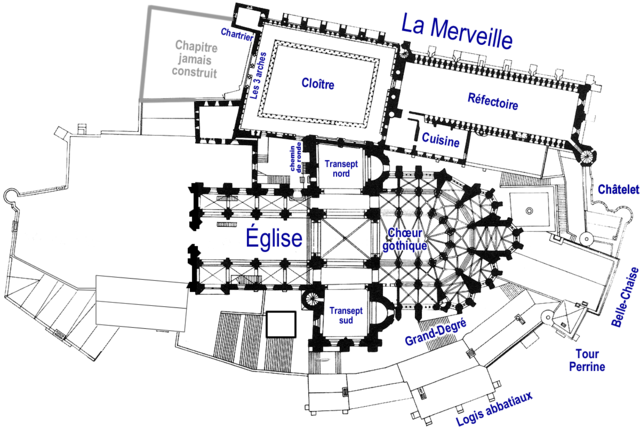
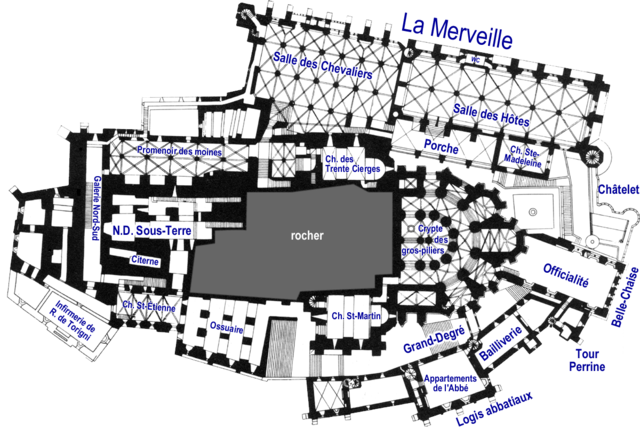
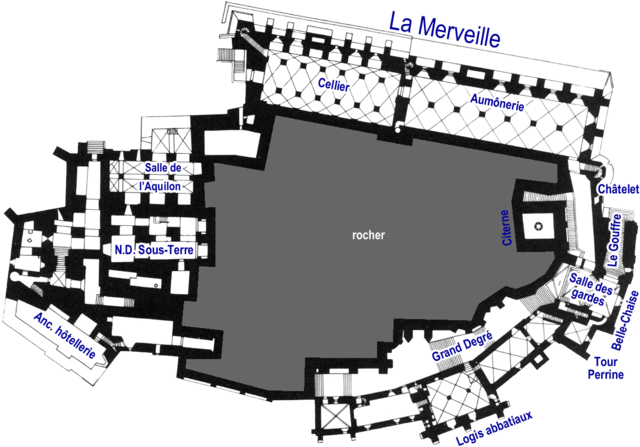
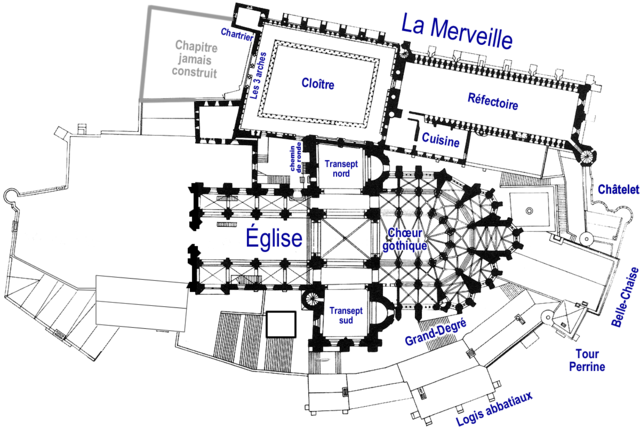

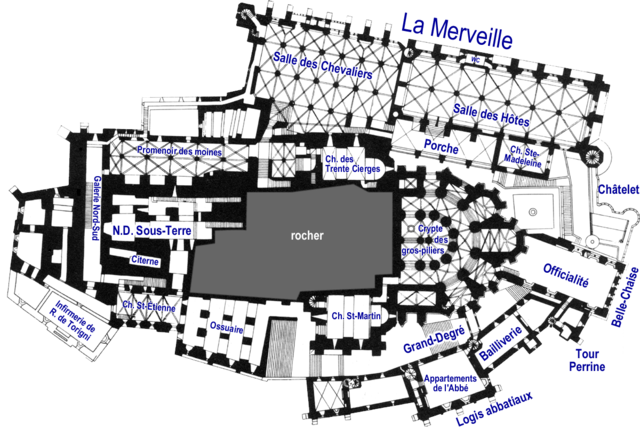



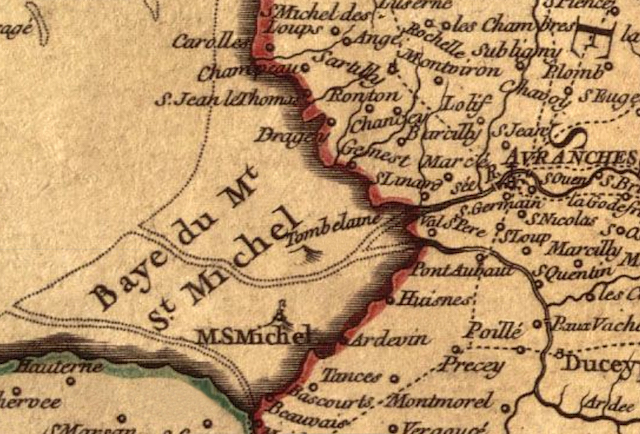
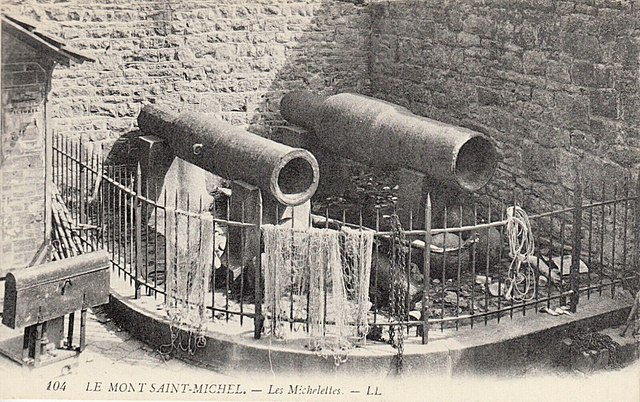










.jpg)
.jpg)




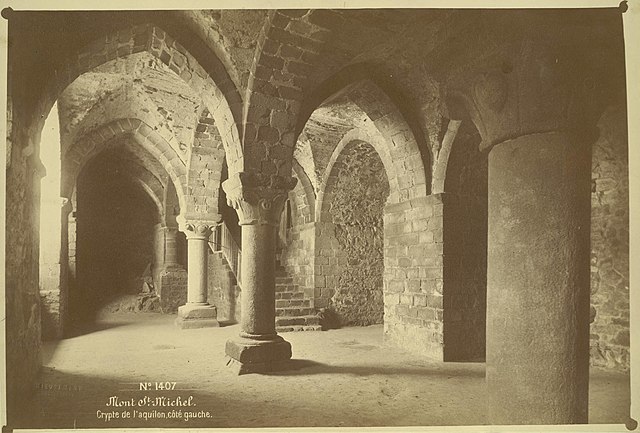




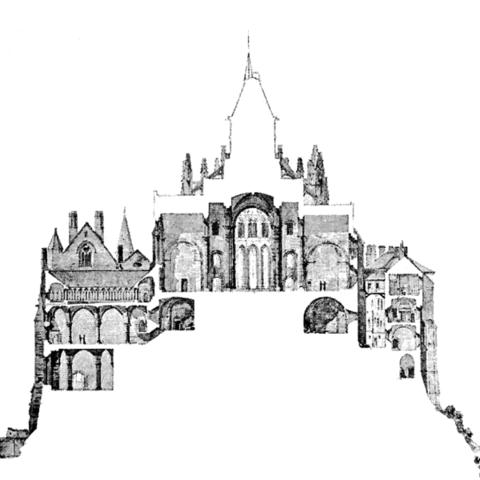
.jpg)
.jpg)







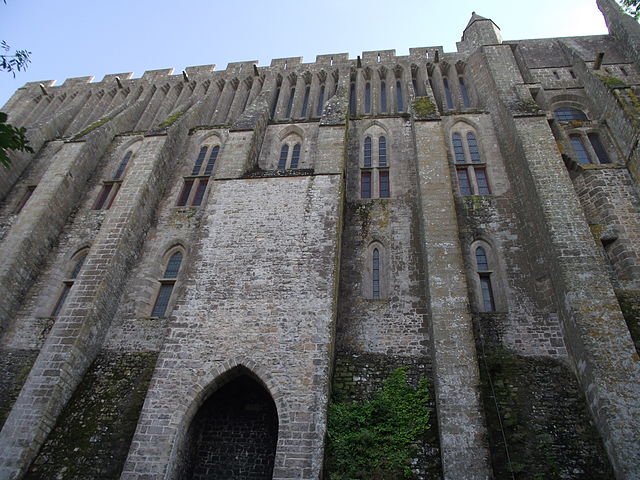
.jpg)




