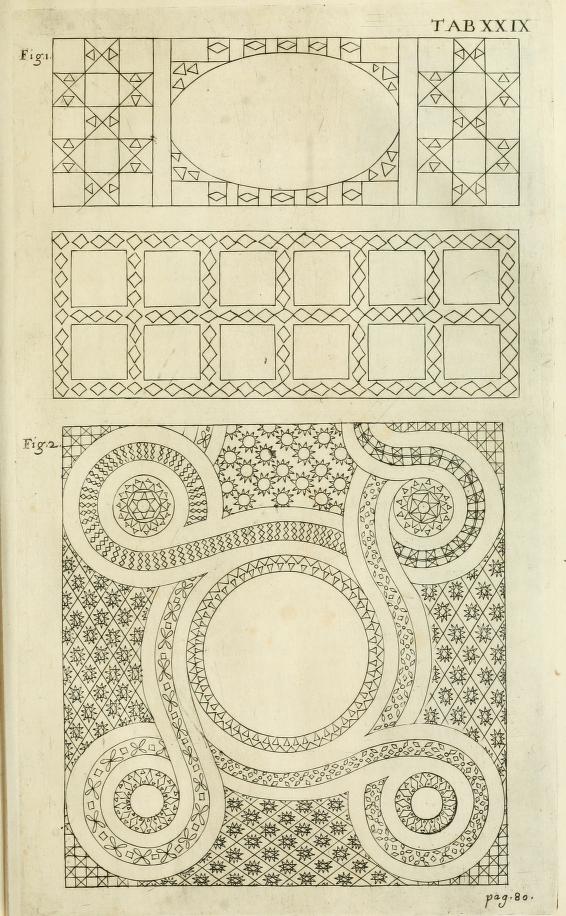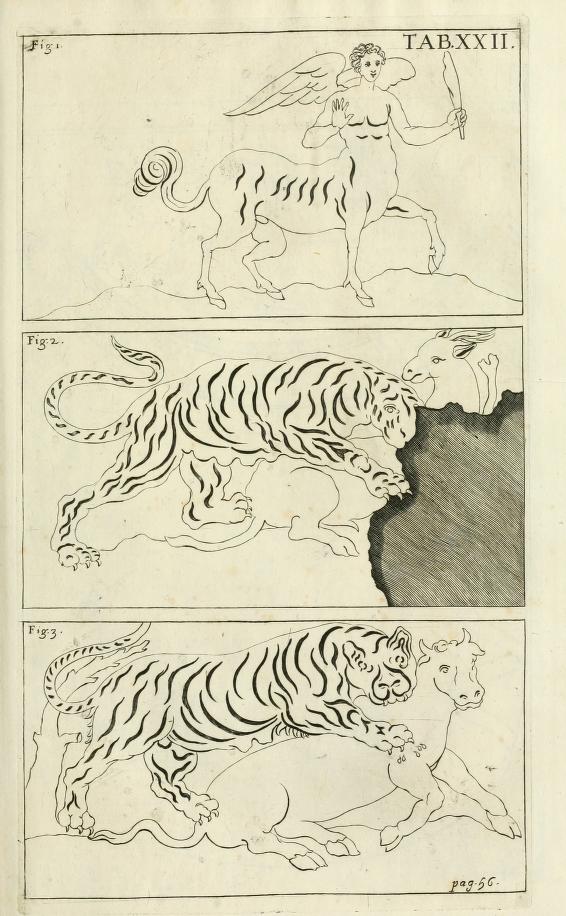| L'extérieur : descriptif |
| L'extérieur : la façade |
| L'extérieur : les portes de bronze |
| L'extérieur : les mosaïques de la façade extérieure |
| L'extérieur : la lunette |
| L'extérieur : le quadrige |
| L'extérieur : les piliers d'Aquitaine |
| L'extérieur : la pierre du ban |
| L'extérieur : les tétrarques |
| L'extérieur : le narthex |
| L'extérieur : le narthex, coupole de la Genèse ou de la Création |
| L'extérieur : le narthex, les niches à côté du portail |
| Les mosaïques : introduction |
| Les mosaïques : or et inscriptions |
| Les mosaïques : opus tesselatum et opus sectile |
| Les mosaïques : les mosaïques de l'atrium |
| Les mosaïques : les mosaïques du transept nord |
| Les mosaïques : les mosaïques de la Chapelle Zen |
| Les mosaïques : les auteurs des caricatures |
| Les mosaïques : les maîtres et l'origine |
| Les mosaïques : mosaïques de l'intérieur |
| Les mosaïques : l'intérieur - la coupole du presbytère |
| Les mosaïques : l'intérieur - les deux transepts |
| Les mosaïques : l'intérieur - les voûtes sud et ouest |
| Les mosaïques : l'intérieur - l'Oratoire du Jardin |
| Les mosaïques : l'intérieur - la coupole de la Pentecôte |
| Les mosaïques : l'intérieur - la contre-façade intérieure |
| Les mosaïques : l'intérieur - San Cesario, le saint contre les inondations |